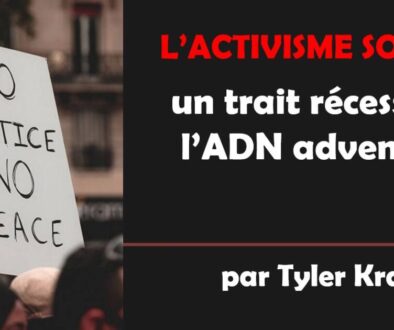Semaine de la sensibilisation aux personnes transgenres et journée du souvenir trans
par Esther Loewen | 6 juillet 2023 |
Alors que je suis transgenre et une femme mariée à une femme, je suis aussi blanche, instruite, valide, chrétienne, fertile et socialement bien connectée. Je suis propriétaire de ma propre maison et de mes véhicules. J’ai la quarantaine, et je parle et écris l’anglais couramment. Tout cela pour dire que, même si je fais l’expérience de la discrimination en ce qui concerne mon genre et ma sexualité, je vis ma vie quotidienne avec un bon nombre de privilèges. J’imagine que beaucoup de lecteurs d’AT peuvent en dire autant.
Ayant vécu presque toute ma vie en jouant le rôle d’un pasteur, chrétien, cis, hétéro et mâle, j’ai eu le privilège d’ignorer l’existence d’évènements telle que la Journée du souvenir trans. Je pensais ne pas connaître de personnes trans victimes d’homicide ou qui s’étaient ôté la vie. Par conséquent, implicitement, je les considérais extrêmement rares.
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que je vis en accord avec moi-même. Le privilège de l’ignorance ne m’est plus possible. Sur les services d’écoute par téléphone et dans mon travail en tant que thérapeute stagiaire dans un centre de santé mentale pour les personnes LGBTQ+, j’ai été bouleversée par l’ampleur du traumatisme endémique au sein de la communauté des individus non-binaires. Dans mes interactions personnelles avec des transgenres qui n’ont pas encore fait leur coming-out, je les ai entendus décrire, encore et encore, la situation inextricable dans laquelle ils se trouvent: la transition ou la mort. Je connais personnellement la souffrance ressentie lorsqu’on se trouve face à un tel choix.
Pour les transgenres, la Journée du souvenir trans (le 20 novembre cette année) commémore l’injustice à laquelle nous faisons face dans une société transphobe, patriarcal, raciste et misogyne. Pour les individus cisgenres, ce n’est pas tant une invitation à se commémorer qu’un encouragement à faire grandir l’empathie et la prise de conscience.
La mortalité des individus transgenres
Dans la prochaine décennie, la mortalité (quelle qu’en soit la cause) des transgenres est plus de deux fois plus probable que celle de leurs homologues cisgenres (Landon et al., 2022). Par ailleurs, ils sont plus de quatre fois plus à risque de mourir par suicide que la population générale et huit fois plus à risque s’ils sont chrétiens (prenons bien le temps de considérer cela) (The Trevor Project). Les personnes trans sont deux fois plus à risque d’être victimes d’homicides que la population générale, et les femmes trans de couleur sont encore plus à risque, car elles représentent environ 75% des homicides transgenres.
Malheureusement, ces nombres déjà ahurissants sont presque certainement inférieurs à la réalité en raison de la pression exercée sur les personnes trans à rester incognito. Un groupe incalculable de personnes non-binaires se suicident ou sont tuées chaque année avant de faire leur coming-out. Elles sont enterrées et pleurées sous leurs fausses identités, méconnues même sur leurs actes de décès et leurs pierres tombales.
Chaque année, la Journée du souvenir trans nous invite à pondérer la perte des individus victimes de l’hégémonie transphobe culturelle, mais elle nous pousse aussi à reconnaître l’étendue du problème. Vous pensez peut-être ne pas connaître une personne trans, mais je peux presque vous assurer que ce n’est pas le cas. Elles restent peut-être incognito ou se font passer pour cisgenres, et elles se demandent si, en vous confiant leur secret, elles seront avec vous en sécurité.
La visibilité est une épée à deux tranchants
En 1988, Anne Bolin a publié In Search of Eve: Transsexual Rites of Passage. Entre autres problématiques, elle décrit les perspectives des femmes transsexuelles de son époque en ce qui concerne la visibilité. Elle dit que la majorité des transsexuelles souhaitent moins de visibilité plutôt que le contraire. Selon leurs perspectives, la situation idéale serait d’être capables de se fondre dans la société, avec ses rôles et ses hiérarchies, sans être remarquées.
Ce qui pourrait expliquer ce point de vue, c’est la question de sécurité. Plus nous sommes connues et reconnaissables, plus nous sommes à risque dans un contexte transphobe. Les femmes transsexuelles de l’époque (on le comprend aisément) pouvaient difficilement imaginer un futur où être ouvertement trans serait une possibilité. Dans ma vie, il y a une époque où je vivais aussi sous le couvert de cette croyance.
Dans l’Amérique d’aujourd’hui, les individus transgenres sont plus visibles qu’à n’importe quelle autre époque de l’histoire de ce pays. La personne ignorante associera peut-être cette réalité avec une dégradation de l’humanité. Mais la vérité, c’est que les individus non-binaires ont fait partie de l’humanité depuis toujours. (Voir l’excellent ouvrage publié par Susan Stryker qui décrit les transgenres au cours de l’histoire.) Nous faisons partie des variations normales et diverses des êtres humains; nous en avons toujours fait partie. Et nous sommes beaux et belles.
Mais avec la visibilité vient aussi le risque que les femmes transsexuelles des années 80 redoutaient. Nos identités sont devenues comme un ballon idéologique: il est passé, repassé et frappé par des commentateurs de mauvaise foi et des prédicateurs qui colportent la peur. Mon existence même est une prise de position politique – non pas parce que c’est ce que je recherche, mais parce que je suis une menace en chair et en os à la hiérarchie patriarcale dans laquelle nous sommes tous nés.
Dernièrement, j’ai beaucoup réfléchi à la question suivante: Que se passera-t-il lorsque l’indignation publique se transférera vers un autre groupe marginalisé? Quand j’aurai atteint ce nouveau statut de privilège, est-ce que je me préoccuperai d’eux? Est-ce que je m’en suis préoccupée dans le passé? Est-ce que je prendrai la parole et œuvrerai pour la justice comme je le fais aujourd’hui?
Alors que j’ai agi, dans le passé, de manières que je regrette maintenant, je veux être, pour les autres, le genre d’alliée que j’espère aujourd’hui avoir à mes côtés.
Ma transition est sacrée
Je suis retournée récemment dans la ville où j’ai grandi. Avant d’entreprendre ce voyage, j’étais terrifiée – en partie en raison de l’expérience de vie décrite plus haut. Pendant de nombreuses années, dans ce lieu, j’avais gardé secrètes mes questions au sujet de mon identité afin d’éviter le rejet qui s’est manifesté lorsque j’ai commencé à vivre en accord avec moi-même. Lorsque j’ai fait mon coming-out, la plupart de mes collègues ainsi que mes «frères et sœurs» de l’église ont tout simplement disparu de ma vie. Ne pas savoir pourquoi (tout en sachant exactement pourquoi) est un lourd fardeau à porter.
Ainsi, en m’apprêtant à prendre l’avion, toutes ces pensées me pesaient lourdement sur le cœur. En fin de compte, ma visite bien structurée a été remplie de rencontres et d’activités avec des personnes qui m’ont aimée exactement comme je suis – en fait, rares ont été les interactions hostiles.
Un thème inattendu (mis à part la chaleur et les encouragements avec lesquels j’ai été accueillie) a cependant semblé émerger au cours de ma visite: les interrogations au sujet de ma foi. Ce n’était pas déclaré ouvertement mais, plus d’une fois, j’ai entendu les gens faire discrètement référence à mon incrédulité envers Dieu, à mon abandon de la foi en Jésus ou à ma séparation d’avec le Saint-Esprit.
Essentiellement, ces présuppositions insinuaient que j’avais fait un choix entre ma transition et ma foi. Je n’ai pas eu l’impression que ces commentaires indirects étaient pernicieux. Je crois, par contre, qu’ils prenaient racine dans un manque de connaissance (un manque de visibilité) ou peut-être un manque de créativité.
Bien sûr, beaucoup d’individus LGBTQ+ quittent leurs foyers spirituels après avoir fait leur coming-out. Pendant toutes leurs vies, ils ont été les victimes d’abus: contraints à subir des thérapies de conversion, couverts de honte, mal-aimés, traités comme des citoyens de deuxième classe ou des boucs émissaires, dénoncés par la loi et soumis à l’obsession des autres. Pourquoi resteraient-ils? D’autres, qui ne se considèreraient pas comme traumatisés par la religion, décident tout simplement de s’éloigner de la foi ou d’en choisir une nouvelle expression, comme beaucoup de personnes le font au cours de leurs vies.
Cela dit, il y en a beaucoup qui souhaitent de tout cœur que l’église soit un lieu sûr pour leurs familles et pour eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui, tout comme moi, auraient accepté avec joie de continuer à être pasteurs, en plein accord avec eux-mêmes, s’ils avaient été célébrés dans leurs transitions.
Voici donc un autre effort de ma part à être complètement transparente. Je suis transgenre. Je suis pasteure. Je crois que Dieu m’a créée de cette manière et qu’il m’a appelée à transitionner. Je crois que Dieu se réjouit autant des personnes queer comme moi qu’elle se réjouit des personnes âgées qui servent de la soupe aux sans-abris, à l’église, toutes les semaines.
Qui plus est, en raison de mon existence en tant que femme transsexuelle – dont la vie est précieuse et sacrée – vous voyez des facettes de Dieu que vous n’auriez peut-être jamais soupçonnées. Les chrétiens queers existent. Les adventistes queers existent. Ils ont toujours existé; ils existeront toujours. La question est de savoir si nos frères et sœurs cisgenres et hétérosexuels nous remarqueront.
 Esther Loewen («Elle» pour ses amis) vient de Walla Walla, dans l’état de Washington, et vit maintenant en Californie. Son but dans la vie, c’est de créer des espaces d’inclusion, cherchant à faire toujours plus de place autour d’une table accueillante et aimante. Elle a été pasteure à temps plein pendant 16 ans (dont une décennie à l’église de l’Université de Walla Walla), elle a publié un livre sur le fait de garder des secrets et a obtenu un master en leadership au séminaire de théologie Fuller. Après avoir transitionné et être devenue une femme transsexuelle, Esther a changé de carrière: elle étudie à l’heure actuelle pour devenir thérapeute familiale. Elle est mariée avec Paige, sa partenaire de 17 ans. Elles ont deux enfants brillants, créatifs, énergiques et pleins d’empathie qui répondent aux noms de Sawyer et Finley. Elle peut être contactée via twitter et Instagram ou sur son site web: www.estherloewen.com. La version anglaise de cet article est parue le 18 novembre 2022 sur le site d’Adventist Today.
Esther Loewen («Elle» pour ses amis) vient de Walla Walla, dans l’état de Washington, et vit maintenant en Californie. Son but dans la vie, c’est de créer des espaces d’inclusion, cherchant à faire toujours plus de place autour d’une table accueillante et aimante. Elle a été pasteure à temps plein pendant 16 ans (dont une décennie à l’église de l’Université de Walla Walla), elle a publié un livre sur le fait de garder des secrets et a obtenu un master en leadership au séminaire de théologie Fuller. Après avoir transitionné et être devenue une femme transsexuelle, Esther a changé de carrière: elle étudie à l’heure actuelle pour devenir thérapeute familiale. Elle est mariée avec Paige, sa partenaire de 17 ans. Elles ont deux enfants brillants, créatifs, énergiques et pleins d’empathie qui répondent aux noms de Sawyer et Finley. Elle peut être contactée via twitter et Instagram ou sur son site web: www.estherloewen.com. La version anglaise de cet article est parue le 18 novembre 2022 sur le site d’Adventist Today.
Pour rejoindre la conversation, cliquez ici.