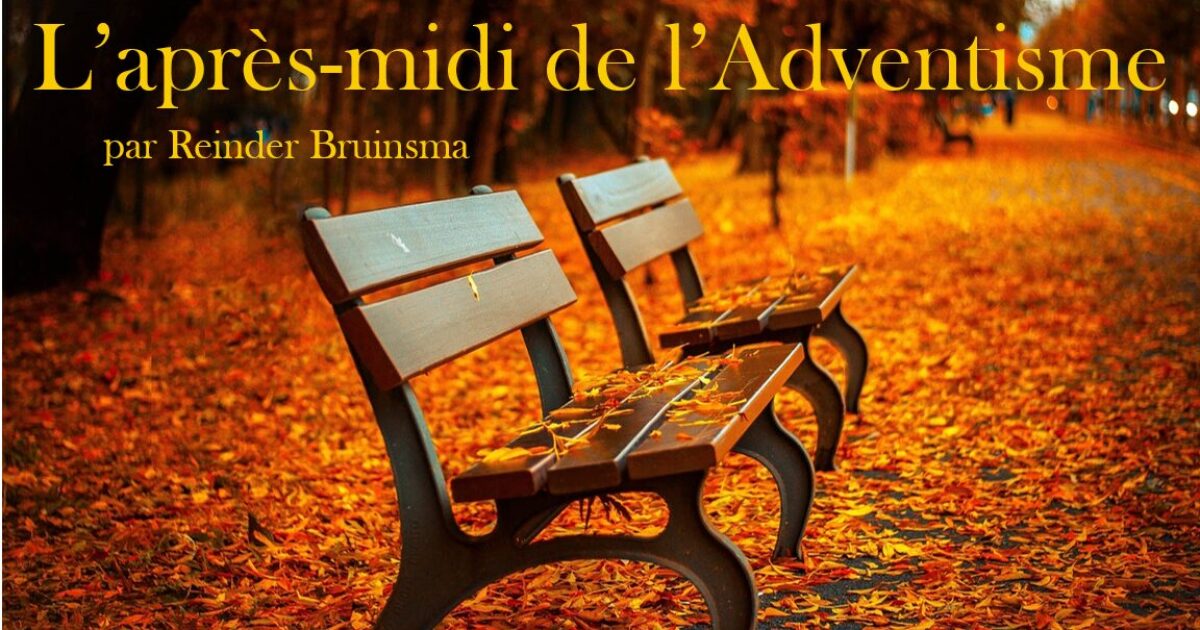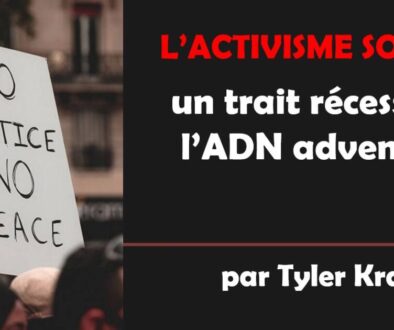L’après-midi de l’Adventisme
par Reinder Bruinsma | 8 mai 2025 |
Après une récente journée de prédication et d’enseignement à Stuttgart, en Allemagne, on m’a gracieusement offert un exemplaire du dernier livre de Tomáš Halík, The Afternoon of Christianity: The Courage to Change.
Tomáš Halík (né en 1948) est un prêtre catholique romain et un théologien tchèque qui a acquis une renommée considérable en tant que philosophe et sociologue. Il a été secrètement ordonné prêtre en 1978 et a travaillé comme prêtre clandestin dans son pays pendant l’ère communiste. En 1989, après le rétablissement de la démocratie, il est devenu conseiller du président Václav Havel pour aider à restaurer la vie religieuse dans son pays. Halík reste une voix influente et ses livres ont été traduits dans plus de vingt langues.
Dans ce nouveau livre, Halík explore les défis contemporains du christianisme et plaide pour une transformation de la foi.
Une Église en crise
Tomáš Halík aime son Église, un fait dont il a donné une preuve convaincante pendant les années où il a servi en tant que prêtre clandestin. Son autobiographie From the Underground Church to Freedom (University of Notre Dame Press, 2019) est à la fois fascinante et donne à réfléchir, surtout pour ceux qui pensent que seuls les croyants protestants ont souffert pour leur foi.
En raison de sa loyauté envers son Église, Halík a le droit d’être critique concernant son état actuel – et l’état du christianisme en général. Halík considère son Église, l’Église catholique romaine, comme une partie du christianisme; il ne traite jamais les autres chrétiens comme des personnes de seconde zone ou en dehors de la «vraie» Église. (C’est bien mieux que ce qui peut être dit de certains d’entre nous). Le titre de son dernier livre porte sur l’ensemble du christianisme, et pas seulement sur l’Église catholique romaine.
Le psychiatre Carl Gustav Jung (1875-1961) a comparé la vie humaine au déroulement d’une journée, où le matin est suivi du midi, puis de l’après-midi. Le matin de la vie humaine d’un individu est souvent suivi d’une crise de la quarantaine, avant que l’âge mûr et la vieillesse ne constituent l’après-midi et le soir de la vie. Halík utilise le concept de «l’après-midi du christianisme» pour décrire l’état actuel de l’Église chrétienne. Selon Halík, le christianisme traverse une grave crise de la quarantaine: un changement et un renouvellement radicaux s’imposent si l’on veut que l’Église ait un avenir digne de ce nom.
La crise du christianisme est particulièrement visible dans le monde occidental où l’Église perd des membres, où la fréquentation est en baisse et où le nombre des personnes qui se sentent appelées à exercer un ministère a atteint un niveau historiquement bas. L’Église catholique en particulier a souffert de scandales sexuels et financiers et de luttes de pouvoir internes. L’unité de cette Église laisse beaucoup à désirer et les différences internes sont souvent plus importantes que celles qui existent entre les catholiques et certaines autres dénominations. Bien qu’en de nombreux endroits, l’engagement des laïcs catholiques soit considérable, «il est toujours lié au principe selon lequel toute activité laïque doit être dirigée et contrôlée par la hiérarchie» (p. 82).
Tomáš Halík est convaincu que la foi chrétienne a dépassé les formes initiales de la religion et que «toute tentative de la ramener à l’une des ses formes antérieures est contre-productive» (p. 42). Néanmoins, nous, chrétiens, avons besoin d’une communauté pour y vivre notre foi. «Dans la réalité historique, nous sommes toujours entrés en contact avec la foi au sein d’une culture, d’un système culturel» (p. 57). La question vitale pour l’Église catholique romaine, ainsi que pour l’Église chrétienne en général, est de savoir si elle peut offrir un foyer commun à différents types de religiosité (p. 98).
En fin de compte, souligne Halík, la survie de l’Église repose sur la combinaison d’une plus grande spiritualité et d’une pertinence distincte dans notre monde sécularisé actuel.
Crise de l’adventisme
La description que fait Halík de l’état du catholicisme romain actuel ressemble étrangement à celle de l’adventisme du septième jour contemporain. La plupart des problèmes qu’il remarque dans son église sont également vrais pour la mienne. Après des années de croissance forte et régulière, le nombre de membres a stagné dans de nombreux endroits du monde. Dans certaines régions, des baptêmes en masse ont encore lieu, mais la question que Halík pose à propos de l’Église catholique romaine – à savoir si l’Église se contente de produire des statistiques sur les personnes baptisées plutôt que sur les chrétiens pratiquants – s’applique également à l’Église adventiste.
Notre dénomination adventiste est, elle aussi, confrontée à un taux de rétention déplorable – plus de 40 % des personnes nouvellement baptisées quittant l’Église après un séjour relativement court. Dans de nombreux endroits, la fréquentation des églises atteint des niveaux inquiétants.
Il est également vrai que les différences internes concernant les doctrines et le style de vie sont souvent plus importantes que l’expérience des membres avec les chrétiens d’autres dénominations. Je dois admettre que je me sens parfois plus proche de Dieu lorsque je rencontre des chrétiens appartenant à d’autres confessions que lorsque je suis assis dans certaines des écoles du sabbat auxquelles j’assiste.
L’opposition (jusqu’à présent couronnée de succès) des hauts responsables de l’adventisme à l’idée d’autoriser les femmes à exercer un ministère sur un pied d’égalité avec les hommes est l’une des principales raisons pour lesquelles il y aura une pénurie dramatique de pasteurs adventistes en Occident dans un avenir prévisible.
La polarisation de l’Église adventiste s’est aggravée au point que beaucoup pensent qu’un schisme entre les différents segments de l’Église est inévitable – et on peut se demander si une telle scission n’a pas déjà eu lieu de facto, en dépit de toutes les dénégations. L’énorme influence des ministères indépendants représentant l’aile conservatrice de l’Église, ainsi que le renforcement constant de la voix des organisations représentant le segment plus libéral de l’Église – tous deux échappant largement au contrôle de la Conférence générale – montrent que l’adventisme a perdu une grande partie de son unité organisationnelle et théologique d’antan.
La crise de la quarantaine
Revenons à la métaphore de Halík sur le christianisme du matin, du midi et de l’après-midi: je crois qu’il y a des raisons de se demander si cette métaphore décrit aussi le passé, le présent et l’avenir de l’adventisme.
Notre Église a été un mouvement religieux couronné de succès. Au cours des 150 dernières années, le message adventiste a touché le cœur et l’esprit de dizaines de millions de personnes dans presque tous les pays du monde. Elle disposait de mécanismes novateurs et bien orchestrés pour transmettre ce message. Cependant, ces mécanismes de diffusion appartiennent aujourd’hui pour la plupart au monde du passé.
Le facteur le plus important est que le message lui-même a perdu une grande partie de son pouvoir de conviction. Après presque deux siècles passés à dire aux gens que Jésus revient «bientôt» – probablement au cours de leur vie – il est devenu impossible de maintenir notre élan d’antan. Parler de lois mondiales sur le dimanche et d’un scénario de fin des temps qui s’appuie sur une façon de penser qui date du dix-neuvième siècle ne parvient pas à inspirer les croyants adventistes d’aujourd’hui. Pour beaucoup, ce sont de vieilles nouvelles, de plus en plus irréalistes.
Beaucoup se demandent si leur Église peut encore satisfaire leurs besoins spirituels – si elle peut offrir la perspective d’espoir dont le monde a besoin en cette ère imprévisible et effrayante de Trump et de Poutine. Ils voient une Église qui s’oriente régulièrement vers un évangélisme nationaliste, d’une part, et qui ne leur donne pas l’espace spirituel dont ils ont besoin, d’autre part.
Survivre à l’après-midi
Une question que Halík pose au sujet de son église s’applique également à ma communauté de foi adventiste: comment pouvons-nous nous débarrasser du fondamentalisme et du fanatisme en notre sein? Halík décrit le fondamentalisme comme «l’utilisation sélective et délibérée de textes sacrés sortis de leur contexte» et le fanatisme comme «l’incapacité et le refus de dialoguer et de réfléchir de manière critique sur ses propres opinions» (p. 71). Qui peut honnêtement nier qu’il y a beaucoup de fondamentalisme et de fanatisme dans nos rangs?
Nous ne pourrons dépasser notre crise de la quarantaine que lorsque nous comprendrons que nous avons besoin d’un autre type d’Église que celle que l’adventisme nous offre aujourd’hui. L’Église qui va rassembler 100 000 personnes pour une démonstration d’unité lors de notre session quinquennale de la Conférence générale à Saint Louis présente, malheureusement, une fausse image. Nous sommes aujourd’hui une Église fragmentée. Nous devons aller au-delà de la politique d’élection de nos dirigeants – ce résultat méticuleusement orchestré et soigneusement préparé par un grand comité de nomination composé d’initiés – pour découvrir où l’Esprit veut nous conduire.
Dans l’après-midi de notre existence confessionnelle, nous avons besoin d’une spiritualité nouvelle et plus profonde qui remplacera l’endoctrinement intolérant des enseignements traditionnels. Nous devons faire preuve d’ouverture à l’égard de ceux qui, à tous égards, ne pensent pas comme nous, et construire (comme le suggère Halík) une «Église sans frontières», avec quelque chose de comparable au parvis des non-juifs du temple de Jérusalem (p. 102) pour accueillir ceux qui pensent que nous avons des choses valables à proposer mais ne sont pas tout à fait prêts à se joindre à nous.
L’Église adventiste peut-elle avoir un avenir significatif? Peut-elle même survivre? Les dénominations, comme la plupart des autres organisations, connaissent des cycles de vie, et nombre d’entre elles disparaissent ou survivent sous une forme considérablement modifiée. Je ne crois pas que notre Église soit proche d’une scission catastrophique en deux ou plusieurs fragments; ma plus grande crainte est que nous soyons plus proches d’un conservatisme dominant, parallèlement à un exode silencieux de ceux qui peuvent encore s’accrocher à des valeurs chrétiennes adventistes vitales, mais qui sont incapables de rester dans un environnement qui menace de les étouffer.
J’espère que certaines choses pourront changer lorsque l’Église se réunira à Saint-Louis, que certaines initiatives pourront être prises en vue d’un après-midi plus radieux. Mais en toute honnêteté, je n’ai pas beaucoup d’espoir que cela se produise.
Toujours l’espoir
Cela ne veut pas dire que je suis désespéré. Le changement viendra d’en bas et non d’en haut. C’est ce que Halík envisage pour l’Église catholique romaine, et c’est, je crois, ce qui se produira également pour l’Église adventiste. Les membres des églises locales et d’autres groupes de chrétiens adventistes engagés n’ont pas besoin d’attendre que des initiatives soient votées par tous les canaux confessionnels traditionnels, mais peuvent choisir de construire une Église (est-ce trop demander que d’espérer même, ici et là, une fédération?) «sans frontières». Ils peuvent créer des lieux où de nouvelles spiritualités se développent et prospèrent, un environnement où une réflexion critique peut avoir lieu sur la manière dont les enseignements et les valeurs du christianisme adventiste peuvent être traduits en un type de christianisme qui inspirera à nouveau les gens. Cela inclut ceux qui sont aujourd’hui sur le point d’abandonner l’adventisme, mais aussi ceux qui recherchent désespérément une communauté spirituelle dynamique où ils peuvent se sentir chez eux.
A Saint Louis, les fidèles chanteront sans doute le cantique qui, depuis des décennies, est chanté lors des Conférences générales: «Nous avons cette espérance qui brûle dans nos cœurs». Je ne serai pas à Saint Louis, mais j’ai toujours cet espoir: que notre Église retrouve une nouvelle forme de vitalité alors qu’elle entre dans son après-midi.
 Reinder Bruinsma vit aux Pays-Bas avec sa femme, Aafje. Sur trois continents, il a servi l’église adventiste dans les domaines de l’édition, de l’éducation et de l’administration. Il maintient toujours un emploi du temps bien chargé, partagé entre la prédication, l’enseignement et l’écriture. Il blogue sur http://reinderbruinsma.com/. La version anglaise de cet article est parue le 30 avril 2025 sur le site d’AdventistToday.
Reinder Bruinsma vit aux Pays-Bas avec sa femme, Aafje. Sur trois continents, il a servi l’église adventiste dans les domaines de l’édition, de l’éducation et de l’administration. Il maintient toujours un emploi du temps bien chargé, partagé entre la prédication, l’enseignement et l’écriture. Il blogue sur http://reinderbruinsma.com/. La version anglaise de cet article est parue le 30 avril 2025 sur le site d’AdventistToday.